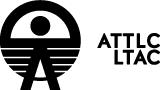Il faut traduire poétiquement la poésie. Cela peut paraitre allant de soi, comme un truisme, mais il n’y a rien de moins évident, car il faut d’abord s’entendre sur le sens des mots. D’abord, qu’est-ce que la poésie ? Ensuite, que signifie « traduire poétiquement » ?
La poésie n’est pas la rime. Confondre les deux, c’est réduire la poésie à un de ses aspects, la reclure dans l’espace de l’intraduisible, et du même coup ouvrir la porte à toutes les libertés en traduction. Celles-ci ne sont souvent qu’abdication et soumission à une idéologie de la langue, de la poésie, et de la traduction.
La poésie, c’est le rythme, dans le sens holistique que donne Henri Meschonnic au terme. C’est le corps qui s’inscrit dans le langage du poème, à travers la sémantique des positions, le choix des mots, les réseaux de métaphores et d’images, etc. Si alors le poème c’est « le langage que le poète a inventé pour dire ce qu’il n’aurait pas pu dire autrement » (Jean Cohen), la poésie n’est plus conçue en termes d’ornement et d’esthétique, mais en termes de nécessité et de poétique. Dans cette perspective, les images doivent être comprises, et traduites, à la lettre.
Ainsi, traduire poétiquement la poésie c’est la lire, non pas à travers l’écran de l’idéologie (de la poésie et de la traduction), mais la lire, pour ainsi dire, dans le texte, pour (re)-produire un texte, c’est-à-dire une machine productrice d’effets et de sens.
J’illustrerai mes propos avec quelques exemples de l’ultime poème du poète palestinien Mahmoud Darwish, Lā‘ibu-nnard, littéralement : le joueur de dés. Écrit peu avant sa mort, ce poème est considéré comme le testament poétique et personnel du poète. Le joueur de dés est un poème mallarméen : d’abord par son titre, qui évoque immanquablement Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. Le mot arabe pour « hasard », muṣādafah, revient d’ailleurs comme en écho tout au long du poème. C’est aussi un poème nietzschéen, car c’est à travers ce hasard, s’incarnant dans une série d’évènements dans la vie du poète qui ont fait de lui qui il est alors qu’il aurait pu « ne pas être », que s’affirme la nécessité, c’est-à-dire le destin. Gilles Deleuze nous dit que pour Nietzsche, contrairement à Mallarmé, Nécessité et Hasard sont inséparables, et c’est de leur opposition que vient la négation de la vie, le « nihilisme ». Dans le poème de Darwish aussi, le hasard est affirmation de la Vie, victoire pour la Vie qui, par une série de hasards dans lesquels le poète n’avait rien à voir, l’a sauvé de la mort à plusieurs reprises. Comme pour Nietzsche aussi, la vision tragique du monde chez Darwish est profondément joyeuse, gaie, une célébration de la vie.
Cette corrélation hasard-nécessité/destin chez Darwish s’incarne dans un mot essentiel dans le poème (un « mot poétique », nous dirait Meschonnic) : ḥaẓ, qui porte en lui à la fois le sens de hasard et de destin. Le mot revient lui aussi tout au long du poème comme un leitmotiv. Ainsi, le vent est le ḥaẓ du voyageur, Dieu est le ḥaẓ du prophète, l’inspiration est le ḥaẓ des esseulés, etc. Le mot revient 17 fois. La traduction française, signée par Elias Sanbar, historien et poète palestinien, utilise chance, coïncidence, providence (Dieu est la providence du prophète). Cette variation entame la systématicité du texte qui se fonde, entre autres, sur le retour délibéré, voire obsessionnel, d’un mot. Avec le choix de providence, cette variation censure aussi l’image.
Justement, les images. Les images elles aussi sont rationalisées, ramenées à ce que nous pourrions appeler « le sémantiquement correct ». En plus de l’impératif de la clarté, l’idéologie de la poésie comme ornement est ici à l’œuvre : l’image est conçue comme une « belle manière » de dire quelque chose, d’exprimer un sens déjà-là, donné. Si La Fontaine dit « Sur les ailes du temps la tristesse s’envole », c’est qu’il a « voulu dire » que le chagrin disparait avec le temps ; si la Bible dit « le chant est qui chante », cela signifie que les choristes chantent, etc. Opposition entre le sens « propre » et le sens « figuré », la métaphore, mais est-ce toujours une métaphore quand on ne pas peut dire autrement, nous dirait Henri Meschonnic ?
Un exemple du Lanceur de dés :
(…) šam’altu, šarraqtu, ġarrabtu,
Amma-l- ǧanūbu, fa kāna qaṣyyan ‘aṣiyyan ‘alayyâ, li anna l-ǧanūba bilādī
Fa ṣirtu maǧāza sunūnūwatin, uḥalliku fawqa ḥutāmī, rabī ‘an, ẖarīfan
u ‘ammidu rīšī bi ġaymi l-buẖayrati (…)
Voici la traduction d’Elias Sanbar :
(…) du nord, de l’est ou de l’ouest
Le sud, quant à lui, me fut lointain et insaisissable, car le sud est ma patrie.
Je devins métaphore d’hirondelle, planant par printemps et automne, au-dessus de mes débris
Baptisant mon plumage à l’eau du lac (…)
Le poète raconte son exil au Liban, à partir duquel il pouvait aller où le vent (qui est le ḥaẓ du voyageur) voulait l’emmener, au nord, à l’est, à l’ouest, mais pas sud, puisque le sud est désormais la Palestine occupée. Il devint alors métaphore d’hirondelle pour pouvoir atteindre et survoler le lac dont les rives sont devenues majoritairement israéliennes, et baptiser son plumage, non pas à l’eau du lac comme l’écrit Sanbar, mais aux nuages du lac (ou sur le lac) : une métaphore de baptême pour une métaphore d’hirondelle ! Cette image disparait dans la traduction, car elle est rationalisée, banalisée, diluée dans « le sens ».
Ne pas reculer donc devant la récurrence d’un mot dans un poème et ne pas céder au réflexe de recourir aux « synonymes » pour donner l’illusion du naturel. Ne pas reculer non plus devant la hardiesse des images, ne pas succomber à l’idéologie de la clarté en les diluant, car par la poésie, le poète recompose le monde et lui donne un sens, son sens. Il le condense. « Telle est la vie, fluide, et moi je la condense », disait Mahmoud Darwish.
Ghassan Lutfi est traducteur littéraire et chercheur en traductologie. Il a enseigné la traduction, l’histoire et la critique des traductions pendant plus de 15 ans à l’université. Il a publié plusieurs traductions en arabe, notamment Trois jours et une vie de Pierre Lemaitre, Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? de Pierre Bayard et Bird Box de Josh Malermann. Sa dernière traduction, parue en 2022, est de la pièce de théâtre longtemps restée inédite de l’écrivain algérien Mohammed Dib Le Vœu de la septième lune. Il a publié plusieurs articles et chapitres de livres en arabe et en français et deux livres en arabe : L’Absolu critique(2019), consacré à la pensée traductologique du traducteur et traductologue français Antoine Berman, et Introduction à l’histoire de la traduction (2022). Il travaille actuellement sur la traduction d’un roman : L’Autrede Charles Le Blanc, traducteur et écrivain canadien et professeur à l’université d’Ottawa.